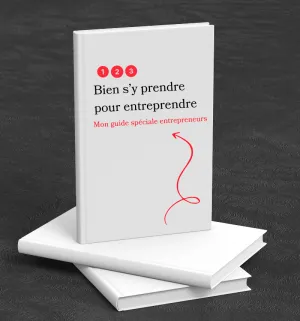Seuls 5 600 entrepreneurs depuis 2014 ont bénéficié de ce statut unique
Sommaire
Sur environ 40 000 étudiants accompagnés depuis 2014, seuls 5 600 ont réellement obtenu le Statut National d’Étudiant-Entrepreneur (SNEE). Un écart qui pose question sur la lisibilité, l’accès ou la logique de sélection du dispositif. Pourtant, pour ceux qui l’obtiennent, les résultats sont concrets.
Un statut méconnu mais structurant pour les porteurs de projet
Le SNEE n’est pas un simple label. Il structure le parcours de porteurs souvent jeunes, techniques, peu familiers avec les codes du montage d’entreprise.
- 75 % des bénéficiaires exploitent le dispositif de manière active à très active.
- 70 % déclarent un engagement fort ou très fort dans leur projet entrepreneurial.
- 20 % continuent à se faire accompagner au-delà d’un cycle universitaire classique.
C’est un accompagnement par l’action, avec un mix de coworking, de mentorat, d’ateliers et d’expertises métiers. Mais l’accès reste restreint. La sélection n’est ni automatique ni massifiée.
94 % de satisfaction : efficacité reconnue, mais faible diffusion
L’étude 2023 montre que 94 % des étudiants-entrepreneurs se disent satisfaits du dispositif, contre 76 % en 2016. Une progression forte, qui tranche avec le faible taux d’entrée en comparaison des effectifs de l’enseignement supérieur.
Parmi les bénéfices les plus mentionnés :
- Renforcement de la lisibilité du projet.
- Mise en réseau avec des acteurs clés (experts, incubateurs, financeurs).
- Montée en compétence sur la gestion, la stratégie, l’itération produit.
- Seulement 30 % de créations réelles, mais un impact qualitatif élevé
Sur l’échantillon étudié, 30 % ont créé une entreprise encore active. Ces structures génèrent 2,4 emplois en moyenne, souvent dans des secteurs en mutation : numérique, transition écologique, innovation sociale.
- 69 % des entreprises ont une finalité sociale ou environnementale affichée.
- 10 % adoptent un modèle coopératif.
- Le reste choisit des statuts commerciaux classiques mais avec un ancrage territorial fort.
L’effet ne se mesure pas uniquement en volume de créations, mais en capacité à accompagner des projets qui, sans cela, seraient restés informels ou inaboutis.
Un vivier de compétences sous-utilisé dans les logiques d’assurance
Les jeunes passés par le SNEE deviennent souvent soit des fondateurs, soit des intrapreneurs aguerris. 71 % d’entre eux déclarent que cette expérience les aide dans leur poste actuel, y compris s’ils n’ont pas poursuivi dans la voie entrepreneuriale.
Et pourtant, ce vivier est encore faiblement adressé par les assureurs spécialisés. Peu de solutions adaptées à leur stade de maturité, à la fragilité de leurs revenus ou à leur mode d’organisation hybride.
Une forte intention d’entreprendre… bridée par le système
92 % des répondants envisagent de créer une entreprise à l’avenir. Le chiffre reste élevé même chez les salariés (87 %). Plus l’engagement est fort dans le dispositif, plus l’intention est maintenue : 94 % chez les très engagés, contre 76 % chez les moins actifs.
Mais cette intention se heurte à un paradoxe : le statut est performant mais trop peu diffusé. Seuls 5 600 bénéficiaires officiels sur une base de 40 000 accompagnés. Soit un taux de transformation administrative inférieur à 15 %.
Conseils pour les entrepreneurs techniques en phase d’incubation
Si vous êtes en début de parcours, porteur d’un projet technique ou innovant, mais peu formé à l’environnement business :
- Ciblez le bon moment : beaucoup de créateurs entrent dans le dispositif après avoir déjà lancé leur activité. Mieux vaut y entrer dès la phase de structuration.
- Choisissez le Pépite adapté à votre secteur : les réseaux sont différents selon les académies.
- Expliquez la valeur d’usage de votre projet dès le pitch : les comités de sélection recherchent des projets concrets, pas des idées abstraites.
- Pour les assureurs, une fenêtre stratégique à ne pas manquer.
Ces entrepreneurs de première génération ont des besoins bien identifiés : RC pro, mutuelle, prévoyance, protection du dirigeant, statut du conjoint, couverture sur projet non immatriculé.
Peu savent vers qui se tourner. C’est donc un marché d’entrée stratégique pour capter des clients en phase de constitution, avec des solutions packagées, évolutives, et accompagnées d’un discours pédagogique.
Et en Europe comment cela se passe ?
Lorsqu’on compare le dispositif français à ce qui se fait à l’international, le Statut National d’Étudiant-Entrepreneur reste un cas à part. Peu de pays disposent d’un statut légal spécifique adossé à l’enseignement supérieur, reconnu à la fois par les universités, les ministères et les acteurs économiques.
En Allemagne, par exemple, l’entrepreneuriat étudiant est souvent laissé à l’initiative des écoles ou des universités techniques (les Hochschulen), mais sans statut officiel national. Au Royaume-Uni, les enterprise hubs universitaires sont bien financés, mais réservés à certaines élites académiques, sans dispositif juridique ni social dédié. Aux États-Unis, les campus disposent d’accélérateurs puissants (MIT, Stanford, Berkeley), mais là encore, aucune reconnaissance statutaire ne permet aux étudiants de bénéficier de droits sociaux tout en développant une entreprise.
La France se distingue donc par une volonté d’institutionnaliser l’entrepreneuriat étudiant à grande échelle, avec un maillage territorial (le réseau Pépite) et une articulation avec les cursus diplômants. Mais cette avance est fragilisée par la sous-utilisation du statut : seuls 5 600 bénéficiaires formels en dix ans, sur un vivier potentiel de plusieurs centaines de milliers d’étudiants. Le problème n’est donc pas la conception du modèle, mais son accessibilité, sa diffusion et sa visibilité.